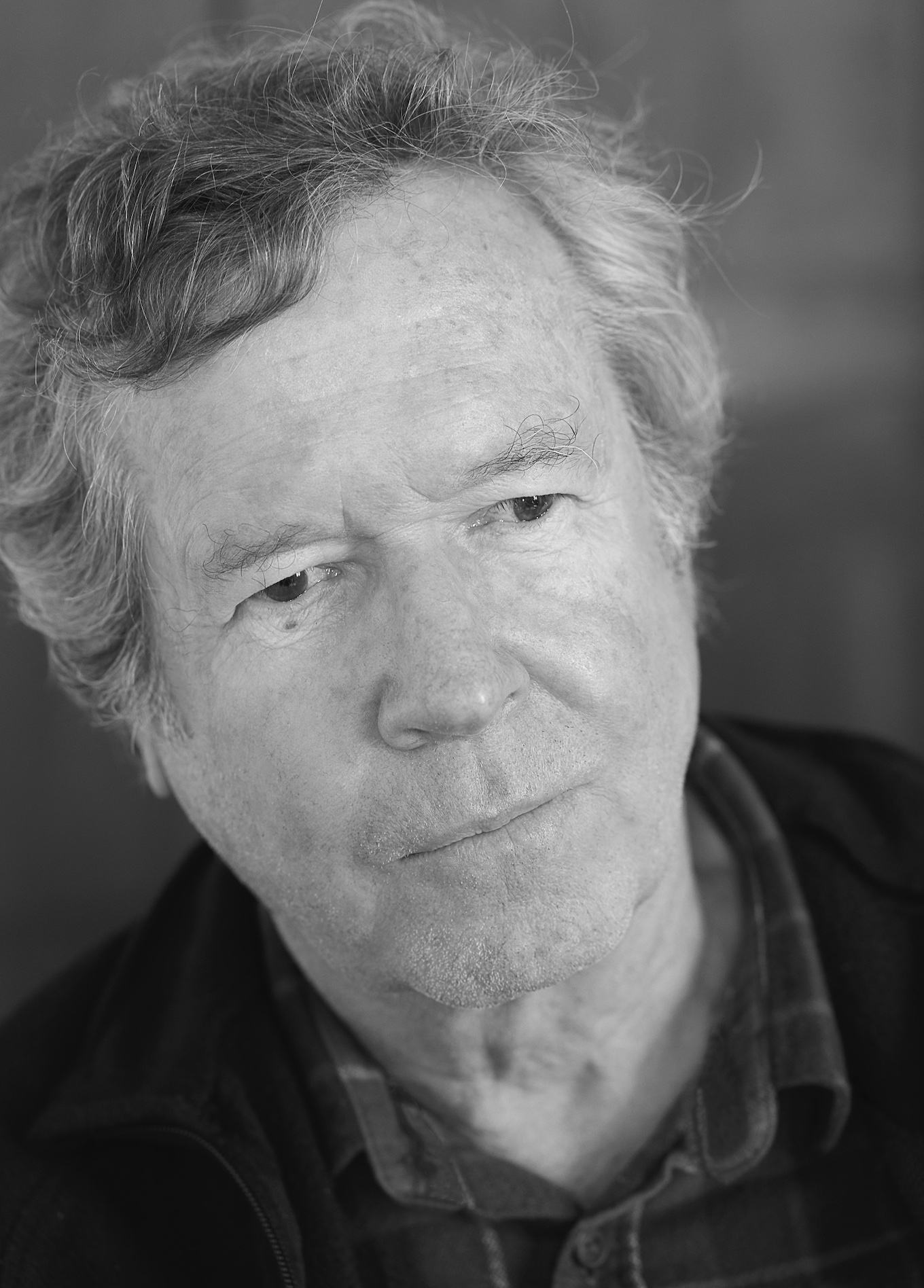LA PRÉSENCE DE LA FAUTE DANS L’ŒUVRE DE MONIQUE SAINT-HÉLIER
Même si les autres vous laissaient libre, — mais ils ne vous laissent pas libre, — on n’est jamais seul dans une faute; on est deux ou trois, collés, agglutinés comme les raisins à la grappe. C’est un Chanaan à rebours, une faute, un pays riche, riche … et si sombre.
Dans le prolongement des études consacrées au tragique de l’amour chez Monique Saint-Hélier, cette lecture tente de montrer les causes de l’impossibilité d’être heureux en amour, en repérant notamment les traces du texte biblique dans l’œuvre; ainsi, la notion de la Faute telle qu’elle apparaît dans l’ensemble des romans est presque toujours liée à la question de la transgression amoureuse, cet enfer en dehors duquel il n’y a pas grand-chose.
1. La faute
A quoi tient la fascination que le monde de Monique Saint-Hélier exerce sur le lecteur ? D’abord à une forme de nostalgie, celle d’un monde où l’on roule en calèche (odeurs de vieux cuir, parfums évanouis de femmes langoureuses), où les portraits de famille vous observent, où les jeunes filles vont au bal chaussées d’escarpins dorés… Dans ce monde disparu, la beauté semble encore possible, les demeures aristocratiques hébergent d’anciennes familles au passé prestigieux, on se croirait chez Tolstoï et le Jura vous a un petit air de taïga. Cet univers est d’autant plus séduisant qu’il se sait en sursis: les personnages vivent de souvenirs, les maisons de famille sont hypothéquées, le passé est fragile …
Mais la nostalgie explique la séduction et non pas la grandeur.
Il doit y avoir autre chose, un poids plus lourd que celui du passé révolu, un poids métaphysique, et peu à peu on prend conscience que dans ce monde romanesque nourri d’épisodes bibliques, le sentiment de la Faute habite tous les personnages, sans exception; une faute majuscule, biblique elle aussi, sans aucune mesure avec les petits péchés que nous commettons chaque jour…
Quelle peut être cette faute d’autant plus inquiétante que le lecteur en connaît assez mal la nature ? Remarquons d’abord qu’elle se transmet des parents aux enfants, pèse sur des personnages que l’on jurerait innocents, se manifeste avant tout dans le domaine des relations amoureuses et surtout chez les personnages féminins dont la foi est profonde.
Dans Bois-Mort, le thème apparaît avec Abel, figure exemplaire et admirable – colporteur de Bibles, handicapé et déformé, habité par la foi, un saint en quelque sorte… Le narrateur a cette remarque significative à propos de Carton, son chien bâtard :
Que les enfants soient à ce point responsables des fautes de leurs parents, c’est bien dur; mais Abel qui vivait dans la lumière pensait que son chien était beau.
Bois-Mort, p. 138
Le motif sera repris dans un roman ultérieur :
Né d’une lévrière des Alérac disqualifiée par sa fugue – elle portait un nom ravissant : Zibeline. Le père et la mère avaient commis leur œuvre vraiment à l’étourdie. Ou peut-être s’agissait-il d’une rencontre de nuit, quelque chose de très précipité, une bousculade de quai de gare, dans un fracas de portes et d’adieux.
L’Arrosoir rouge, p. 47
Le lecteur ne peut s’empêcher de songer à Carolle Alérac qui se juge doublement coupable: sur elle pèse la faute de sa mère, Alexandrine, qui a trompé son fiancé en fautant avec un Espagnol; de plus, elle se juge responsable du décès d’Alexandrine, morte en couches. Le texte nous renseigne peu sur ce sentiment de culpabilité terrible, mais ces silences soulignent l’horreur de la situation de Carolle :
[…] le jour de sa naissance était le jour sinistre de la vie Alérac. Chaque année, elle souhaitait qu’on ne la réveillât pas, ce matin-là ! […] De tout, elle savait seulement que Madame Vauthier l’avait emmenée avec le dernier paquet de linge sale, et qu’il y avait du sang partout.
Le Cavalier de paille, p. 86
Or, le Journal inédit de l’auteur nous apprend que la naissance de Monique Saint-Hélier a coûté la vie à sa mère, que son père ne pouvait s’empêcher de lui faire sentir sa responsabilité, qu’elle a été hantée par la présence de cette morte au point d’aller apprendre ses leçons au cimetière, assise sur la tombe maternelle. Nul doute que la malédiction prend ici sa source.
Le texte biblique nourrit l’ensemble de l’œuvre romanesque, avec deux pôles privilégiés, la Genèse et l’Apocalypse. C’est toutefois le Décalogue qui fonde la question de la faute, cette réflexion de Mme Vauthier à propos de son amour caché pour Guillaume Alérac le montre clairement :
… Ah ! cet amour était un mal, elle le savait. Elle n’avait pas l’habitude de prendre des moutons pour des carpes, n’est-ce pas? Et puis elle connaissait le Décalogue et les commandements de Dieu … Je suis le Dieu fort et jaloux qui punit l’iniquité des pères sur les enfants, jusqu’à la quatrième et la cinquième génération.
Le Cavalier de paille, p. 22
Toute faute nécessite une expiation, et l’on n’est guère étonné de voir que les héroïnes ont une conscience aiguë du prix à payer pour leurs errements, qui ne leur ont pas même apporté le bonheur. Le point commun à toutes ces femmes est qu’elles ont aimé un homme dont l’amour leur était interdit.
Alexandrine, coupable, paie de sa vie quelques moments de bonheur volés dans les fameuses Carrières. Et son fiancé Bertrand paiera à son tour pour n’avoir pas su garder la jeune fille du danger, il est apparemment condamné à une vie entière de solitude non pas amère, mais comme éteinte. Guillaume lui en a longtemps voulu, le jugeant responsable de la catastrophe, mais à la fin de sa vie il ne le condamne plus, et disculpe du même coup sa propre fille qu’il avait pourtant, de dépit, presque reniée :
« Il aurait voulu prendre sa petite morte dans ses bras, – il la voyait avec la robe du «portrait jaune», – lui dire: «Regarde, tu n’es pas très coupable, pas aussi coupable que tu ne l’as cru … »
Le Cavalier de paille, p. 85
Lorsque Sisy de la Tour, la sœur du pasteur, se rend chez Graew dans l’espoir de le voir une dernière fois avant son mariage (mais avec quel projet, le séduire ?), il nous est dit que «sa conscience effrayée l’escortait, esclave fidèle et pleine de honte … » (Le Cavalier de paille, p. 143).
Quant à Mlle Huguenin, la vieille fille, la «sainte du village», qui a désiré Jonathan pendant des années en silence, elle se trouve dans l’allée des Fonceaux au même moment que Sisy, avec les mêmes intentions, et des pensées identiques:
On ne peut pas savoir combien elle se méprisait, dans quel abîme de mépris on peut tomber. Et qui, pour se juger, peut être plus dure qu’une femme droite?
Le Cavalier de paille, p. 144
On pourrait se demander en quoi consiste ici la faute… ce n’est certes pas la confection naïve de gilets de chasse pour les hommes célibataires qui paraît bien damnable … Mais Mlle Huguenin, lectrice de la Bible, en juge autrement, et selon les paroles du Christ, «Vous avez appris qu’il a été dit… Mais MOI, je vous dis…» (Bois-Mort, p. 249) elle a au cours de ses innombrables rêveries amoureuses consacrées au beau Jonathan Graew, commis le péché d’intention, suffisant à vous damner éternellement :
Mais des mots qui la condamnaient, quelque chose venait, quelque chose qui était son étroite part, sa toute petite part en ce monde: elle n’avait jamais rien eu d’autre, jamais rien … mais ça, oui: l’adultère avec lui dans son cœur.
Bois-Mort, p. 249
Ici, comme au théâtre (deux épigraphes du Martin-pêcheur sont empruntées à Marivaux) les serviteurs répètent dans leur monde les fautes des maîtres – à la différence que chez Monique Saint-Hélier la hiérarchie est inversée, et ce sont les servantes qui incarnent les valeurs morales, tandis que certains maîtres ont perdu le sens de la culpabilité, ou du moins l’ont noyé dans l’alcool ou le divertissement.
Ainsi, Félicie Vauthier est coupable d’avoir aimé Guillaume en silence; il le savait sans doute, ses regards sont éloquents; il lui a un jour donné «la fleur de réséda», et cela fait cinquante-huit ans de peine pour un «amour insensé» (Le Cavalier de paille, p. 46).
Elle payait pour tous, et elle aimait mieux ça. — Son enfant était mort, son mari était mort; on lui avait pris sa maison; elle servait chez les autres…
Le Cavalier de paille, p. 22
Pendant des années elle a suivi Ishbel Alérac comme son ombre, lorsque la femme de Guillaume avait des rendez-vous amoureux avec un inconnu (le lecteur apprendra par la suite qu’il s’agissait du cousin de Guillaume, Jasper), et ceci parce qu’elle ne pouvait pas accepter qu’on trompe l’homme dont elle était amoureuse en secret :
Des mois entiers sans plus entrer dans une église; elle était comme Caïn, qui se cachait, mais elle, ce n’était pas de peur… Elle ne voulait pas qu’on le trompe, voilà! – Elle ne voulait pas qu’un autre prenne la femme de Guillaume Alérac.
[…]
Et si Guillaume Alérac avait levé un doigt, seulement le doigt… ah si on pouvait savoir comme elle aurait été à lui, trop heureuse seulement d’imaginer ces choses.
Le Cavalier de paille, p. 63
Et la faute n’est pas loin:
C’est peut-être de cela qu’elle était morte, Ishbel Alérac, d’avoir toujours devant elle cette femme impassible, ces yeux sans insolence et sans mépris.
Ibid., p. 62
De plus, elle se juge coupable d’avoir intercepté, dans le but de protéger Guillaume, les lettres d’amour que Jasper envoyait à Ishbel. Elle, la servante parfaite, elle a volé ! Par amour, mais volé tout de même, et fouillé dans les secrets des autres, tout comme Jonathan, dont elle se sentira proche pour la première fois (Le Cavalier de paille, p. 360), viendra fouiller dans sa commode à la recherche de son livret bancaire. Madame Vauthier est donc à la fois pécheresse elle-même (bien qu’elle ait payé) et agent du destin implacable, puisqu’elle jouera ce rôle de statue de la justice devant Jonathan comme elle l’avait fait devant Ishbel.
Il en va de même dans Le Martin-pêcheur pour Taby, l’intendante qui tient chez Balagny le rôle de Madame Vauthier. Une fois de plus, la clé se trouve être la question de la faute, et cette fois un modèle littéraire est mentionné : Dostoïevski. Taby cite Humiliés et Offensés, ce qui éclaire la personnalité d’un «Extra» étonnant que les autres ont baptisé Spartacus, un révolutionnaire russe exilé qui médite les ouvrages de Lénine et paraît pour le moins incongru dans le monde des Balagny, même si le Jura a longtemps été terre d’accueil pour les proscrits. Mais ici la révolution est moins politique que métaphysique, et le Tzarevitch qui comme par hasard est lui aussi un obsédé de la propreté et du nettoyage compulsif rêve moins d’organiser la grève générale que de confondre Tim, le Don Juan valet, au moment où celui-ci s’apprête à séduire Christie, une domestique pure et vierge qui à l’étage des valets reprend le rôle de Catherine et de Carolle tout à la fois, et dont le prénom à lui seul indique le rôle central. Or, quel est le piège que monte Spartacus ? Il tente Tim au moyen d’une pièce d’or, pour l’inciter à voler, donc pour le prendre en faute, le faire pécher, ou comme le dit Taby, le mettre dedans.
La Lady Black ne le lui pardonne pas, elle qui sait combien le monde de la faute est effroyable :
– Dans quel monde horrible les poussez-vous? Et pourquoi ?
… Est-ce qu’il connaissait quoi que ce soit au monde de la faute? … est-ce qu’il connaissait sa géographie désespérée, les petits chemins et les grandes avenues, les culs-de-sac, les voies de garage d’où l’on croyait qu’on allait remonter, retrouver les autres? Et on ne retrouve jamais les autres.
Le Martin-pêcheur, p. 223
C’est enfin la même Taby qui, quelques pages plus tôt, a livré la clef de déchiffrement de cet épisode en posant la distinction fondamentale entre le désir et l’amour :
Un péché qui ressemble si peu à une faute, l’amour… Ah ! Là était la faute, c’est que l’amour n’y était pas.
Le Martin-pêcheur, p. 156
Dès lors, nous comprenons mieux le cas complexe de Jonathan Graew, qui souffre comme un damné de désirer sans savoir aimer. Il voudrait s’approprier de façon presque magique les qualités des Alérac, il tente de compenser dans l’ordre de la possession ce qu’il ne peut pas être, tout en sachant cette substitution vouée à l’échec car toute sa famille souffre d’une culpabilité diffuse, comme l’ont deviné Guillaume et Carolle Alérac dans un instant fulgurant, significativement mis entre parenthèses:
… Vous n’avez jamais eu l’impression, vous, qu’ils se punissaient? …
Le mot fonça sur elle comme un cap. Carolle leva la tête (le rachat du monde sur le dos des Alérac ?)…
Bois-Mort, p. 70
Le rachat des terres Alérac hypothéquées est lié par métonymie au thème de la faute existentielle et du pardon : ce sont les maîtres qui doivent se racheter. Au fond de lui-même, Jonathan, ivrogne, noceur, amateur de femmes faciles (celles du Petit Monaco, qui abrite tous les vices), ne cesse d’errer à la recherche de la pureté. Celle de Mlle Huguenin qui a fixé une fois pour toutes la perspective de son salut impossible, puis celle de Catherine, la fille «blanche» qui fuira toujours au-delà du cercle de la possession.
Son idéal semble être la figure maternelle, et il en est conscient, avec ce mélange de lucidité dans l’ivresse, d’humour, d’autodérision qui épargne aux personnages le ridicule de la convention et des stéréotypes :
Il avait tellement envie d’aimer une femme, une vraie, bonne, pure. Il se mit à rire: … alors, mon vieux ! dans ce cas, il fallait aimer ta mère, et ça n’est pas permis.
Le Cavalier de paille, p. 158
Personnage à la fois christique et démoniaque, il incarne mieux qu’un autre le Coupable (sa «barbe en pointe» est ambivalente). Dans Le Cavalier de paille, lorsque le pasteur imagine de faire jouer un mystère à Noël, il pense bien sûr au Jeu d’Adam et aussitôt Carolle imagine :
– Excellent ! Jonathan Graew sera un Adam magnifique, tellement dans le rôle, avec son air de porter le péché originel tout entier…
Le Cavalier de paille, p. 82
Catherine aura le rôle d’Eve, on s’en doute! D’ailleurs, le serpent apparaît sans cesse dans le roman, en relation avec les jeunes femmes (cf. Le Cavalier de paille, p. 40, p. 65, p. 83) de même que la femme-serpent aperçue sur le marchepied d’une roulotte de forains, et qui hante les rêveries du pasteur Bertrand de la Tour.
2. L’amour
Tous les personnages ont «l’amour dans le sang» comme le dit Macha (Le Cavalier de paille, p. 59) à propos des Alérac dont le pouvoir de séduction se transmet de génération en génération; tous se sentent à la fois coupables et juges : on parle en connaissance de cause. Songeons aux frasques de Guillaume, à ses souffrances d’amant, à sa conscience aiguë des désespoirs amoureux, et cette conviction que ces souffrances sont encore ce qu’on a de plus beau à vivre sur cette terre :
Pourquoi on aime ? … pourquoi on n’est pas aimé ? … qui peut le dire ? Tout cela est inconnu. La seule chose qu’on sache, c’est qu’en dehors de cet enfer, eh bien, on s’aperçoit qu’il n’y a pas grand-chose…
Bois-Mort, p. 190
Cette thématique est bien sûr centrale, mais la faute paraît en être le lieu d’origine, ainsi que le ressort romanesque qui met en mouvement toute la machine dramatique. La lecture du premier roman, La Cage aux rêves, publié en 1932, montre qu’il s’agit là d’un problème que l’auteur a affronté de façon très personnelle. Le texte est à l’évidence autobiographique, et la question de la faute y prend une résonance particulière: «O, que Béate se sent petite et pleine de fautes !» (La Cage aux rêves, p. 52) On a ici une première héroïne accablée par le sentiment de ses insuffisances et habitée par un sentiment religieux un peu étriqué, tempéré par l’humour de la narration :
En sa maison, Dieu est assis, une plume à la main; il feuillette les cœurs; les cœurs plats comme une pièce d’un sou, les cœurs fermés à clef n’ont pas de secret pour lui.
La Cage aux rêves, p. 30
Il est écrit : malheur à ceux qui tournent la tête: ils seront changés en pierre. Ça n’est pas vrai. Ça n’est plus vrai. On ne foudroie plus les coupables, on leur donne tout au plus un petit torticolis, puis ils rentrent dans leur maison [ … ]
La Cage aux rêves, p. 33
C’est dans ce même roman que l’on trouve la première esquisse d’une de ces relations amoureuses à la fois instantanées, absolues, interdites et refusées. Il s’agit toujours de Béate, qui s’éprend en un instant d’un médecin marié à une femme de grande beauté, et passe aussitôt à la jalousie la plus noire – donc à la culpabilité la plus grande.
On ne peut s’empêcher de voir dans cet épisode l’origine de la scène du Cavalier de paille au cours de laquelle Carolle tombe amoureuse du docteur Dessombre. (La scène est étrange, peu préparée en tout cas, à tel point que le lecteur a de la peine à adhérer au monde romanesque … sans doute parce que l’épisode n’est pas exigé par les personnages eux-mêmes, mais bien par des souvenirs personnels si intenses qu’ils ont déterminé la plupart des relations amoureuses des personnages féminins. Vers l’âge de quinze ans, Monique Saint-Hélier s’était prise d’une passion impossible pour un médecin de la Chaux-de-Fonds, homme marié à qui l’on prêtait d’innombrables succès féminins.)
On voit également dans ce passage une première apparition du motif de la clef perdue, qui prendra une importance centrale à cause du Journal rédigé par Alexandrine après ses fiançailles trahies. Après avoir avoué à son fiancé ses amours coupables avec l’Espagnol, Alexandrine a noté dans son cahier: Toutes les clefs sont perdues pour nous … puis, à la page suivante, J’ai gardé la clef de la mort … (Le Cavalier de paille, p. 178) ; ce sont ces mêmes paroles que Carolle adresse en rêve à Jonathan, qui va être abasourdi de les découvrir en feuilletant le cahier dérobé à Mme Vauthier. Chose surprenante, dans L’Arrosoir rouge, Mlle Huguenin, qui a eu l’occasion de lire ce journal, mentionne la même page en d’autres termes:
Mais Alec avait écrit dans son journal : « J’ai perdu les clefs de la mort.»
Elle avait perdu même ça. Qu’est-ce qui vous reste, si la mort même est perdue? «J’ai perdu les clefs», et non pas: «J’ai trouvé les clefs.»
L’Arrosoir rouge, p. 196
La précision exclut une erreur de lecture ou un défaut de mémoire du personnage. Il faut plutôt imaginer une inadvertance de la romancière (L’Arrosoir rouge est publié vingt ans après Le Cavalier de paille), mais cette hésitation est chargée de sens. La première version implique le choix délibéré du péché, la tentation du suicide ou la prescience d’une mort prochaine qui se vérifiera lors de l’accouchement fatal. En revanche, le souvenir de Mlle Huguenin signifie de façon plus tragique la solitude absolue de la «femme adultère», son impuissance à trouver le salut, à être, comme Alice Nicolet par exemple, «délivrée». En ce sens, Alexandrine incarne une malédiction sans rédemption, peut-être parce que sa passion a été consommée, à l’inverse de presque toutes les autres: elle encourt la malédiction de la chair car dans le lieu clos et flamboyant des Carrières elle a succombé à la séduction de l’Espagnol, comme Guillaume plus tard y retrouvera sa mystérieuse Bohémienne. L’amour physique est bien la cause première de la damnation.
3. Le corps
Peut-on parler de la faute et de la culpabilité sans s’interroger sur la relation que les personnages entretiennent avec les choses du corps ? Chez Monique Saint-Hélier, l’érotisme est plus présent et violent qu’on ne le croirait au premier abord, mais toujours refoulé il apparaît surtout dans des rêves ou des rêveries éveillées à la symbolique transparente.
Même une «sainte» comme Mlle Huguenin dans une rêverie induite par un de ses fameux gilets de chasse, lâche la bride à un érotisme violent tout orienté vers la silhouette de Jonathan le chasseur :
L’horreur et la joie de la poursuite se partageaient son corps; elle devenait crosse, fusil, poudre et en même temps cette petite chose plate qui se dégonfle au bord d’un chemin. Ses narines battaient comme deux bras croisés sur sa poitrine, le bonheur lui coupait le souffle, l’étouffait de joie, elle sentait ce bonheur derrière elle, on lui prenait le cou, lui renversait la bouche, la tenait dans un bruit de feuilles et d’éclat de poudre. Ainsi, elle s’en allait, elle s’en allait, si loin, qu’il lui fallut de longues minutes pour retrouver dans le soir immobile, le cercle de la lampe, ses meubles pleins de réserve et ses mains qui tremblaient…
Bois-Mort, p. 249
Une extase peu chrétienne… Ce n’est pas rien, pour le pilier de la paroisse ! Mais elle se rappelle aussi une visite au Petit Monaco, et l’attirance trouble qu’elle a éprouvée face à la patronne qui couche avec Graew (« jeune, les paupières flâneuses, mais pas ce qui veillait dessous. Celle-là savait vous accrocher un homme. Une ventouse. » L’Arrosoir rouge, p. 180) ; elle éprouve une haine fascinée pour tout ce qui touche au plaisir mais la censure morale déplace cette fascination sur une… lampe, détestée !
Elle l’avait prise en grippe, cette lampe, depuis sa plus petite enfance. Elle haïssait ce globe d’albâtre, ce juponnage rouge, tout froufroutant de liberty champagne qui caracolait au-dessus. Elle haïssait cette lumière, dite «d’intimité», et qui avait la couleur d’une rose pourrie.
L’Arrosoir rouge, p. 180
Avec une remarquable économie de moyens, la description de la lampe évoque à la fois les seins de la patronne, l’ivresse, la danse, et le libertinage qui tout ensemble font du Petit Monaco un lieu de plaisir odieux et diablement attirant.
De façon plus générale, la hantise du corps, chez les personnages féminins, va se déplacer sur les objets, et se résoudre en nettoyages névrotiques. On frotte et on nettoie beaucoup dans ces romans, et ici comme ailleurs on peut dire avec Bachelard que « psychanalytiquement, la propreté est une malpropreté » …
… il est assez facile de constater que l’eurythmie d’un frottement actif, à condition qu’il soit suffisamment doux et prolongé, détermine une euphorie. [ … ] Ainsi s’explique la joie de frotter, de fourbir, de polir, d’astiquer qui ne trouverait pas son explication suffisante dans le soin méticuleux de certaines ménagères.
Gaston BACHELARD, La Psychanalyse du feu, Paris: Gallimard, 1949, p. 56.
Ainsi, Madame Vauthier, lorsqu’elle nettoie la maison de Jonathan, fait reluire les parquets pour effacer ses propres fautes; la narration est à cet égard parfaitement explicite :
Elle essayait de se racheter, la chère âme, les robinets étaient témoins, et si les boutons de porte pouvaient parler, ils diraient qu’ils étaient exténués de polissures; la poussière était traquée, les balais s’usaient vraiment jusqu’au manche et quand Jonathan Graew ne savait plus où poser le pied tant les parquets ruisselaient d’éclat, il ignorait que le parfum d’encaustique qui embaumait la maison, venait d’une âme qui payait ainsi son repos.
Bois-Mort, p. 125
Ces activités sont d’ailleurs moins rares qu’on ne pourrait le croire, Mlle Huguenin en est coutumière, elle qui ne cesse de ressasser ses rêves amoureux en pelotant des gilets d’homme et qui est si troublée quand Bertrand de la Tour vient lui rendre visite que «manipulant de fins et nombreux papiers de soie, elle se demandait comment elle pourrait nettoyer les chaussures du pasteur» (Bois-Mort, p. 242). Celui-ci se doute bien du caractère malsain de ces activités ménagères excessives:
«Elles sont folles, toutes, avec cette manie de parquets brillants, ma sœur aussi… » (ibid., p. 243). Ce qui ne l’empêchera pas de nettoyer ses chaussures maculées de boue avec un tisonnier tout en songeant que c’est «boueux et blanc, … comme moi» (ibid.).
On ne sera donc guère étonné qu’il n’y ait pas de naissances, ni de mariages dans ce monde où les jeunes filles sont vouées à la solitude et au désir impossible. Il y a certes les fiançailles de Graew et de Catherine, mais leur avenir est déjà si sombre que l’on a peine à leur imaginer une postérité, et la romancière multiplie les signes qui nous empêchent de voir dans ce mariage la source d’une nouvelle dynastie qui viendrait remplacer les Alérac déchus.
La Colinette, jument de Jonathan, est prête à mettre bas dans Bois-Mort, mais on ne tarde pas à apprendre que le signe était trompeur, et la mort du poulain Jupiter à la fin du Cavalier de paille prend une importance symbolique: la malédiction pèse sur Graew comme sur les Alérac, et il est aussi incapable qu’eux d’engendrer une descendance, malgré les soins maternels qu’il a prodigués à ce poulain emmailloté dans la couverture rose qui était celle du petit Jonathan …
Catherine à cet égard semble tout à fait lucide :
Et puis, elle s’imaginait enceinte de Graew. Son ventre se serra de fureur. – Non, on ne tirerait pas d’enfant d’elle: «Tu n’en auras pas, jamais, jamais.» Elle défiait Graew. Son ventre devenait en bois, un bloc, d’où il ne sortirait rien de vivant.
Le Cavalier de paille, p. 19
Le refus de la maternité est très fort chez Carolle également, les deux filles étant ici liées dans une sorte de haine commune des hommes. Carolle paraît vouée à la virginité, comme son institutrice Mlle Huguenin; quant à Catherine, elle se donnera certes à Balagny au cours d’une nuit sans joie et presque sans amour, «cet amour bâclé» (Le Cavalier de paille, p. 280) sous les yeux d’un Christ mort et saignant de ses blessures, mais elle ne cessera de se voir dans les yeux de son amant d’un soir comme une courtisane : « Au matin, elle ne serait plus que la petite grue qu’on fait déjeuner … » (Le Martin-pêcheur, p. 271).
Par ailleurs, dans la scène du verger elle vit un étrange fantasme de viol par procuration en regardant Carolle embrassée par le docteur Dessombre, qu’elle prend pour Balagny:
Des nausées la prenaient, elle serra le poids de cuivre contre sa poitrine, ses genoux se nouaient comme si quelqu’un tentait de pénétrer son corps, – mais ce n’était pas le sien qu’elle défendait, c’était celui de Carolle Alérac qu’elle fermait, tenait serré, serré, pareil aux genoux des momies.
Le Cavalier de paille, p. 285
L’envie de meurtre n’est pas loin, et bientôt elle lancera ce poids contre sa rivale…
Dans ce monde, la procréation est certes une calamité. Si les bonnes et les concierges sont enceintes, cette fatalité dégoûte les filles de bonne famille, Sisy de la Tour en particulier. Il faut les marier, comme la bonne du pasteur, enceinte des œuvres de Graew semble-t-il, qu’on case en vitesse chez un forgeron.
Néanmoins, à ce refus de la maternité s’oppose la sagesse maternelle des vieilles domestiques comme Madame Vauthier et Taby qui aura peut-être le dernier mot sur cette question :
Aimer un homme ne suffit pas. Il faut l’enfant, les bras d’un enfant autour du cou. Cet enfant qui attend de vous cette chose formidable que nous exigeons de Dieu: d’être le miracle de chaque instant. Un enfant sans mère, c’est un enfant sans miracle. Mais une femme sans enfant, c’est… eh bien, la même chose, soupire-t-elle.
Le Martin-pêcheur, p. 384
4. Le salut, tout de même ?
Oui, nous sont accordés parfois quelques instants de bonheur volé, sans culpabilité, moments de rédemption liés à la contemplation de la beauté du monde (comme cette longue méditation de Mlle Huguenin dans le cimetière de l’Arrosoir rouge), ou encore à la communion fragile entre les êtres.
L’une lui brassait les cheveux, l’autre les ongles, Caralle fermait les yeux, s’abandonnait… C’est le meilleur moment du bal, j’en suis sûre. Elle était dans cet état heureux, pareil aux bords incertains des grandes maladies, où les désirs, les rêves, les souvenirs forment un réseau léger, une sorte de hamac; on flotte, on berce, on dort, ce n’est pas la mort, ce n’est pas la vie, c’est la paix fragile du Premier matin.
Le Cavalier de paille, p. 42
Mais c’est aussi l’humour très particulier des personnages (difficile à dissocier de celui de l’auteur) qui, au sein des moments les plus douloureux, les pousse à ironiser sur eux-mêmes, à ne pas dramatiser, et à échapper à l’apitoiement sur soi-même qui nous détournerait d’eux. Par exemple, au moment du pire tourment de la jalousie, Catherine – elle est cachée et croit voir Carolle embrassée par Balagny dans le verger – prend conscience de sa douleur sur le mode de la dérision : «Partout, sur tous les points de sa conscience, une souffrance maintenant se levait, agitait son petit drapeau.» (Le Cavalier de paille, p. 285). A ce propos, Michel Dentan mentionne cette légèreté ludique qui «porte à sa limite l’équilibre infiniment fragile de la désespérance et de la joie» (Le Jeu de la vie et de la mort chez Monique Saint-Hélier, p. 62).
On peut même se demander si, paradoxalement, ce n’est pas dans la conscience aiguë de leur faute – et de l’éventuelle rédemption – que les héroïnes de Monique Saint-Hélier trouvent cette force de vie, cette énergie farouche qui les rend si attachantes: ces femmes ont péché, elles ont payé et continuent de payer, mais sans se lamenter jamais, sans s’autoriser la moindre sensiblerie, la moindre complaisance dans le chagrin.
Le bonheur, ce serait alors cet espoir de la délivrance (le terme revient souvent) qui habite tous les personnages féminins, et qu’Alice Nicolet, la jeune fille qui agonise à l’hôpital Jérôme Alérac, connaîtra in extremis, mais de manière édifiante, grâce à la confession ultime qu’elle fait au pasteur – et l’on n’est pas étonné d’apprendre que la faute qu’elle doit confesser, c’est encore un amour secret, celui qu’elle éprouvait précisément pour le pasteur, qui tenait dans son cœur la place qui n’appartient qu’à Dieu seul :
– Je vous ai aimé plus que Lui.
La voix était distincte, cette fois aussi nette qu’en ce matin où dans une église de campagne, elle avait ratifié son vœu de baptême, et le visage retomba délivré.
Le Cavalier de paille, p. 110
Il est révélateur qu’avant de mourir, la jeune fille agonisante ait pu donner à son confesseur la promesse du salut, ou du moins l’espoir du pardon :
– Vous aussi… , – le mot trembla sur une tige si longue qu’elle semblait venir de l’autre versant du monde, – … vous serez délivré.
Le Cavalier de paille, p. 100
On relit le cycle des Alérac, on en sort enthousiasmé, accablé aussi par sa beauté et sa grandeur. Est-ce à dire qu’au moment où la conscience de la faute disparaît, la littérature est condamnée à la médiocrité ? Camus avait des choses essentielles à dire là-dessus, et Beckett est peut-être le seul à avoir trouvé le moyen de concilier l’absence de Dieu et la présence hallucinante de la faute, le rachat impossible puisque le péché, maintenant, c’est d’exister :
VLADIMIR. – A cheval sur une tombe, et une naissance difficile. Du fond du trou, rêveusement, le fossoyeur applique les fers. On a le temps de vieillir. L’air est plein de nos cris. (Il écoute.) Mais l’habitude est une grande sourdine.
En attendant Godot, p. 128
Cette sourdine, les femmes délaissées de Monique Saint-Hélier la connaissent bien. Comme elle doit être familière à une Mlle Huguenin ! Et à Carolle, qui au bal rêve de «pousser tout à coup un cri, un vrai cri, un long hurlement d’homme» (Le Cavalier de paille, p. 241). Sans le poids de la faute, la brûlure passionnée des héroïnes s’éteindrait, c’est elle qui donne au monde romanesque sa terrible intensité. Mais dans un monde où l’on n’a plus guère le sens du sacré ou de la transgression, il est difficile d’écrire une œuvre qui connaisse ce frémissement infernal, cette force tragique proche de l’épouvante et de l’ émerveillement…
Quand un auteur aujourd’hui veut poser en détenteur du sens du sacré, il plaque arbitrairement quelque faute épouvantable sur des personnages de papier: les amants se flagellent, les cancéreux prostituent leur épouse (Juive, bien sûr), le romancier brandit le martinet – cela donne La Trinité, roman de l’artifice et de la vulgarité, et le lecteur ne sait s’il doit en rire, ou pleurer.
On regrette alors ce sentiment profond de la culpabilité qui donne à Carolle, à Mlle Huguenin et même à Jonathan une telle présence, au point qu’ils nous habitent bien plus longtemps que d’innombrables héros de roman dont la vie paraît mille fois plus trépidante et digne d’intérêt.
Oui, nous avons la nostalgie de la faute… celle qui faisait les existences douloureuses – et les belles histoires.
Charles E. RACINE
A propos de Monique Saint-Hélier, un article publié dans la Revue de Belles-Lettres en septembre 1978.
Cet article est une réflexion sur un thème que je crois essentiel pour comprendre la nature des conflits relationnels qui donnent au monde des Alérac sa profondeur et son intensité dramatique.
De même que chez Nancy Huston aujourd’hui, les générations de personnages se transmettent, sans vraiment le savoir, un sentiment de faute, de culpabilité souvent paralysant.
Le lien avec le protestantisme est presque trop évident (il faut rappeler que Monique Briod a choisi de se convertir au catholicisme), il n’en reste pas moins que sans cette hantise de la transgression, liée à une recherche plus ou moins consciente du châtiment, la vision du monde des Alérac comme des Graew serait incompréhensible. Ici, l’on est plus proche du monde de Dostoïevski que de celui de Rilke.