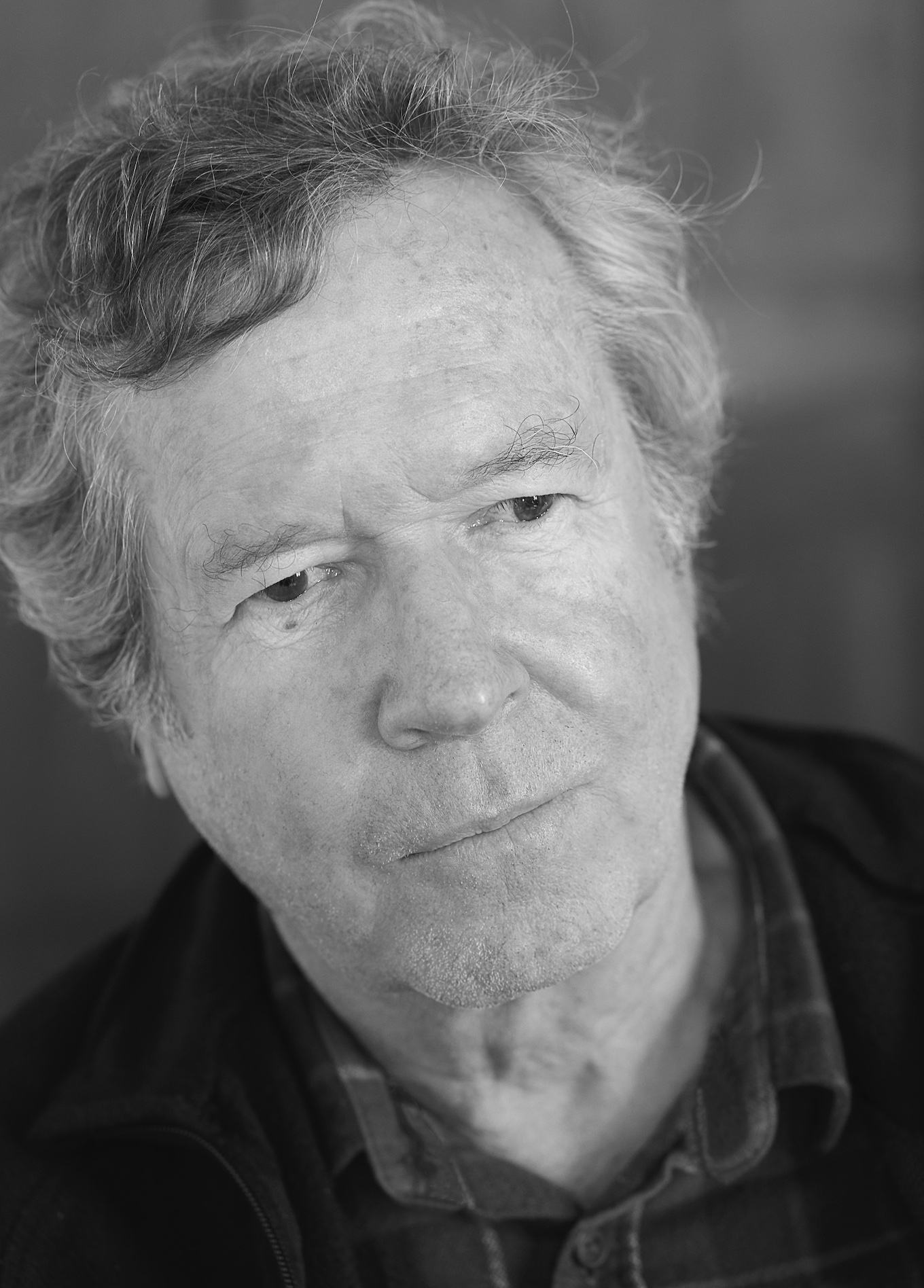L’invention du passé
Une jeune fille tricote. Tout entière absorbée par sa tâche domestique, elle semble parfaitement immobile, figée dans le temps et dans l’espace alors même que ses doigts sont supposés se mouvoir à toute vitesse : enfant j’observais les adultes qui tricotaient, fasciné par la rapidité de leurs gestes et par le staccato de cette petite musique de chambre. Je cherche en vain une expression quelconque sur son visage, un sentiment, une émotion qu’elle éprouverait ou qu’elle serait susceptible de me faire éprouver : en vain, je ne trouve rien. Que se passe-t-il ici ?
Lorsque j’étais étudiant, Anker ne m’intéressait pas : je le trouvais provincial et sans grandeur, je ne le regardais pas vraiment. J’ai changé d’avis dans une certaine mesure et suis prêt à lui reconnaître du talent : c’est un bon artisan, il maîtrise la lumière, la couleur, l’espace, la matière picturale est de belle facture… mais il ne parvient pas à m’intéresser. Cette absence d’émotion me pousse à la réflexion, je cherche à l’expliquer.

Voici une autre version de la fille au tricot : celle-ci pèle des pommes de terre, tout aussi silencieuse, inexpressive et immobile. L’une regarde à gauche, l’autre à droite, c’est la seule différence notable, on croirait que l’artiste a recopié son tableau.
Les jeunes femmes de Vermeer elles aussi sont silencieuses et immobiles, or cela contribue à la fascination que les tableaux exercent. Alors où se trouve la différence ?
Chez Vermeer l’expression du visage est difficile à cerner, mystérieuse, mais ce mystère éveille mon activité interprétative. Chez Anker, les filles sont là, elle travaillent, et c’est tout ce qu’on peut en dire.
Il y a autre chose : le mystère de Vermeer, comme celui de Rembrandt, est dû à une ambiguïté inhérente au tableau, il y a une faille…
« There is a crack in everything
That’s how the light gets in »
(Leonard Cohen)
Pas de faille chez Anker, pas de mystère, pas de lumière intérieure. Ses tableaux me laissent inerte. En paix, certainement, tranquille, mais passif, vaguement ennuyé.
Et puis je réalise que le peintre regarde en arrière, vers le passé. Il me montre la vie domestique, la jeune fille au foyer, obéissante et appliquée, les enfants sages et concentrés, les grands apprennent à lire aux petits, tous ensuite se regroupent comme les poussins autour de la mère poule : la maîtresse est jeune et jolie, aimante, propre. Mais on est en 1884 ! Van Gogh est en train de peindre les Mangeurs de pommes de terre… Là aussi, ce sont des paysans, mais quel contraste ! Les miséreux hollandais sont bien plus crédibles que la jolie fille aux aiguilles. Bien sûr, la bernoise ne vit pas dans la misère, mais elle est trop sage, trop appliquée, elle aussi doit connaître des moments de doute que son père (Anker a peint sans relâche ses propres enfants, ce qui est parfaitement légitime) ne veut pas voir, ou pour le moins refuse de nous montrer. Du coup, il perd mon estime et mon attention.

Je regarde à présent le Soldat de 1830 qui rentre au pays. Je ne me souvenais pas de ce tableau que j’ai pourtant vu autrefois à la Chaux-de-Fonds. Au premier abord, j’imagine un mercenaire rentrant d’une guerre étrangère, hébété par les combats, par ce qu’il a vu et fait, à tel point qu’il doit demander son chemins à des enfants : il est perdu, égaré, en état de stress post-traumatique pourquoi pas ? Un dictionnaire historique m’apprend qu’après la révolution de 1830 Louis-Philippe a renvoyé chez eux les mercenaires helvétiques, ce qui a suscité l’indignation de nos autorités. Notre soldat est donc resté assez longtemps à l’étranger pour avoir oublié le chemin de son village… Et s’il n’a plus de fusil, c’est sans doute parce qu’il a été désarmé… Je m’étonne qu’il soit parti au combat avec son chien domestique, mais que sais-je des coutumes mercenaires ?
Une dernière énigme : au moment où Anker peint son tableau, 1830 est déjà lointain. Même pour les contemporains ces événements datant de quarante-deux ans doivent sembler obscurs. Alors pourquoi peindre ce retour de guerre en 1872 ? Je crois en deviner la raison. Anker a été formé dans l’atelier de Charles Gleyre, ce qui d’ailleurs explique son métier remarquable, il a dû être un bon élève, studieux et appliqué. Il a vécu des années à Paris, a gardé des attaches avec la capitale, rien de ce qui s’y passe ne le laisse indifférent. Et en particulier, pas la Commune. En bon bernois, il a dû être horrifié par le soulèvement populaire, ce retour sans gloire du soldat au village natal est peut-être une façon de nous dire que les révolutions se terminent mal et que les soldats qui les répriment risquent d’en perdre le nord…

Je ne pensais pas, lorsque j’ai songé à la jeune fille au tricot en arriver à des considérations historiques… Mais en relisant ce texte, je suis frappé par l’expression il regarde en arrière… Or je n’ignore pas que le plus grand collectionneur de tableaux et dessins d’Anker est Christof Blocher, qui en possède, dit-on, plus de deux cents. Ce retour vers le passé donne à réfléchir dans la mesure où toute la propagande du mouvement politique des Blocher révèle une volonté délibérée d’exalter un passé idyllique, partiellement détruit ou en tout cas menacé par l’immigration et le cosmopolitisme des « élites ». Précurseur, Blocher partage avec les leaders populistes qui lui ont succédé, les Berlusconi, Bolsonaro, Trump, un mépris de l’Etat providence et des élites dont ils font partie, tout ceci au nom d’un autrefois glorifié.
En ce sens, la famille de ma tricoteuse, la classe d’école sage et appliquée, la leçon de gymnastique à Anet où les petits garçons jouent aux soldats, marchent en rythme aux ordres de leur instituteur qui tape dans ses mains, toutes ces images imposent une vision de la Suisse éternelle éminemment rassurante. Nous savons que Monsieur Blocher, intelligent et cultivé contrairement à ses collègues mentionnés plus haut, est un chef d’entreprise milliardaire qui prône un capitalisme sans frein étatique. Dans sa logique, il est d’autant plus important, pour asseoir le mythe d’un peuple éternellement libre et souverain, de vanter une paysannerie laborieuse, éduquée et disciplinée : les tableaux d’Anker jouent leur rôle à la perfection.
Un autre aspect fait le lien entre le populisme, la paysannerie d’Anker et l’UDC de Blocher.
La lecture de Kundera nous a appris à débusquer une notion à l’œuvre dans toute la production culturelle de notre temps : le kitsch. Pour résumer, est kitsch toute production artistique qui ne souhaite pas donner à réfléchir mais veut plaire à tous et par tous les moyens. Jamais je n’aurais l’idée que les toiles de Vermeer ou de Rembrandt peuvent receler une once de kitsch. Au contraire : elles en sont l’antidote. Ce n’est hélas pas le cas de Anker. Qu’il soit sincère, honnête, bon peintre et bon père de famille, je le concède. Il n’empêche : le monde paysan qu’il nous propose est kitsch dans la mesure où sa paysannerie est fantasmée, ses toiles ne nous disent rien des conditions de vie des vrais paysans, il nous plaît dans la mesure où il nous montre ce qui devrait nous rassurer.
Il y a peu, les officines de l’UDC ont publié, en perspective d’une votation fédérale intitulée « Contre une Suisse à dix millions d’habitants », un tout-ménage odieux qui présentait deux images : à gauche la Suisse cosmopolite des élites, une surpopulation insupportable, un empilement d’étrangers d’origine africaine entassés les uns sur les autres, oisifs, négligés. L’autre photo montrait une famille helvétique modèle : père et mère blonds et roses, enfants se donnant la main dans un paysage bucolique qui pourrait être celui du Soldat de 1830 (il suffirait de mettre des baskets aux gamins).
Les mouvements populistes ont cela en commun qu’ils regardent tous en arrière, comme certains peintres. Ils n’ont pas de projet d’avenir sinon un laisser-faire et une haine de l’Etat, mais ils ont besoin pour faire accepter leurs fables de mobiliser un imaginaire passéiste. Nous avons tous éprouvé la nostalgie des temps où les choses allaient mieux (nous avons bien sûr oublié tout ce qui n’allait pas), et c’est la grande force des illusionnistes qui visent à asseoir leur domination médiatique et politique.